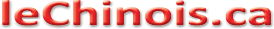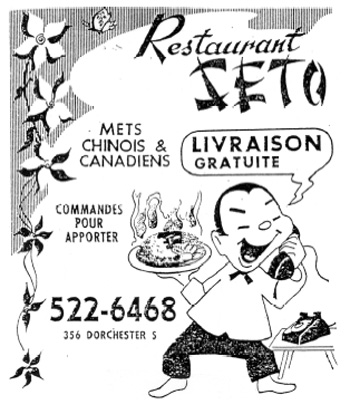Les Chinois de Québec ne vivaient pas en vase clos. Depuis l’arrivée des premiers Chinois, des interactions furent observées avec les autres communautés. En effet, les blanchisseries, puis les restaurants chinois étaient très fréquentés, principalement par les Québécois. Pourtant, l’intégration de cette communauté d’immigrants ne se déroula pas sans heurts. De nombreux articles parus dans « Le Soleil » ou « L’Événement » en 1910 témoignaient par exemple de la mauvaise réputation des buanderies chinoises : elles étaient qualifiées de lieux aux règles hygiéniques douteuses, les buandiers tuberculeux ayant l’habitude, selon les échotiers, de cracher sur le linge. Les journaux de l’époque rapportaient également des actes d’intolérance : que ce soit le refus de payer sa note au restaurant, les injures proférées, le jet de projectiles ou les coups assénés à l’encontre des Chinois. Cependant, tous les Québécois n’agissaient pas de la même façon. La correspondance de l’abbé Adrien Caron illustre, à l’opposé, les gestes d’accueil et d’aide continus de la part de la population locale. Signalons que cette antipathie à l’égard des Chinois se manifestait d’ailleurs dans plusieurs villes du Canada au début du XXe siècle.
|