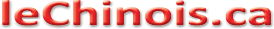Travaux de chercheurs en histoire
Textes
|
|
Rencontres interculturelles entre la Chine et le Canada/Québec au XXe siècle : la perception des jésuites dans la presse périodique québécoise de 1918 à 1949. par Victor Rochette-Coulombe page 12 Conclusion Lorsqu’on s’intéresse à la représentation des Jésuites dans la presse périodique québécoise, quelques grandes tendances apparaissent à l’analyste. D’abord, il est certain que les missions connaissent un plus grand succès au début des années 1930. Avant l’arrivée du Père Joseph-Louis Lavoie comme procureur de la Procure de Chine en 1931, la figure des Jésuites dans la presse est souvent disparate et lacunaire. Rappelons-nous les premiers articles trouvés entre 1918 et 1929 qui présentaient très peu de contenu d’information. Dès lors, on comprend que la mission prend un nouveau virage avec son arrivée comme gestionnaire de l’activité jésuite au Québec. Le développement de la revue missionnaire Le Brigand et du musée chinois à Québec s’imposent comme des moyens financements relativement efficaces. Ainsi, pour la période comprise entre 1929 et 1939, on peut affirmer que la visibilité des missions jésuites s’accentue au fil des années 1930, après l’arrivée du Père Lavoie. Or, ce constat s’effrite peu après 1939, avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Si la représentation des Jésuites s’essouffle un peu, ceux-ci profitent du climat mondial difficile et de la curiosité des lecteurs des journaux pendant le conflit. On aperçoit donc un intérêt marqué pour le sort des Canadiens impliqué directement dans le conflit avec les Japonais en Chine et une récurrence dans les publications. Une représentation qui persiste dans certain périodique québécois jusque dans les années 1970 (15). Parallèlement, il semble aussi que la perception des missions jésuites en Chine reste relativement favorable chez les Québécois entre 1918 et 1949. Malgré quelques préjugés sur la société traditionnelle chinoise, on a pu le constater avec l’utilisation des termes « païens (15) » et par la volonté des Jésuites de démonter certains préjugés sur la Chine par des conférences. De manière générale, les articles sont assez positifs lorsqu’ils abordent l’aventure missionnaire en Chine et leurs activités de financement. Enfin, on pourrait aussi ajouter que les Jésuites ont été les acteurs les plus énergiques d’un ordre religieux sur son déclin. Plus précisément, il est possible que les Jésuites, par leur représentation régulière dans la presse périodique, fussent les garants du renouvellement d’une institution qui commence à perdre son influence et qui cherchait à consolider son hégémonie menacée par « l’affermissement de (certains) processus structurels déjà dominants (comme) l’industrialisation, l’urbanisation, l’extension du salariat, la consommation marchande et la continentalisation des flux économiques (15) ». Des facteurs de changements qui montrent que la société québécoise avait bien amorcé, dans la première moitié du XXe siècle, sa modernité et pris ses distances face à l’Église et ses institutions. Une période de grands bouleversements qui s’illustre avec ce besoin de représentativité que nous avons trouvé dans la presse périodique, de 1918 à 1949. Une période qui précède de peu la révolution tranquille… |
15 Le quotidien du Saguenay, cahier 5, 11 avril 1979, p. 8. 16 Le Progrès du Saguenay, 9 novembre 1931, p. 3. 17 Jocelyn Létourneau, op. cit., p. 202. |
|
|