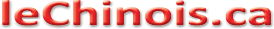Travaux de chercheurs en histoire
Textes
|
|
Rencontres interculturelles entre la Chine et le Canada/Québec au XXe siècle : la perception des jésuites dans la presse périodique québécoise de 1918 à 1949. par Victor Rochette-Coulombe page 10 La Chine a ses lettrés comme les autres pays, sa société cultivée, ses villes luxueuses. Certains grands centres de Chine ne le cèdent pas aux grandes métropoles d’Amérique ou d’Europe (14) ». Par ce passage, on ne peut négliger le fait qu’il règne au Québec un sentiment de supériorité socio-économique envers la Chine, d’abord dévastée par la guerre civile et ensuite les Japonais. Malgré cela, on peut aussi soulever le fait que le développement de la mission va bon train après 1931, et plus spécialement, depuis l’arrivée du Père Joseph-Louis Lavoie dans les rouages de l’administration de la Compagnie de Jésus. La période s’étalant de 1931 à 1949 étant celle dans laquelle nous avons trouvé le plus d’informations concernant les missions. Une relation de causalité qui s’illustre par des publications de plus en plus régulières dans la revue Le Brigand (14) et par le développement du musée chinois à Québec. En effet, dans un numéro de L’Action Catholique daté du 23 août 1933 (14), on peut trouver la mention « d’un superbe musée trop peu connu » (Fig., 3.3) ou encore la photo des membres du comité général de l’exposition missionnaire (Fig., 3.4.). En regardant celle-ci, on peut remarquer qu’il s’agit d’un article promotionnel pour des objets ramenés de Chine par les Jésuites québécois. Une publicité assez importante considérant la taille des images. Parallèlement à cela, on trouve aussi régulièrement la mention du départ de certains jésuites, comme celle de la figure 3.6 où on apprend le « Départ de 5 missionnaires pour la mission de Süchow (14) ». Les Pères Prospère Bernard, Côme Cossette, Pierre Laramée et Alfred Dansereau qui quittent le Canada, pour une dernière fois, en 1938. L’année suivante, avec le commencement de la Seconde Guerre mondiale, on peut percevoir un changement dans le fond des publications. En effet, il semble que les Jésuites sont désormais au centre de l’attention des médias. Dans un exemplaire du journal La Patrie du 30 octobre 1939 (Fig., 4.1), les Jésuites figurent désormais à la première page. On peut lire en grosse lettre que « la liste des dangers auxquels sont exposé nos vaillants missionnaires en Chine, en guerre avec le Japon, s’allonge chaque jour » et que « deux missionnaires canadiens (ont été blessé par une sentinelle japonaise) (14) ». Par ce genre de représentativité, on peut comprendre que le sort des jésuites connaît un nouvel engouement avec le conflit. La population cherchant probablement des référents face à l’anxiété procurée par le conflit, il est possible que les jésuites aient été une figure |
14 Le Devoir, 7 septembre 1946, Vol. XXXVII, No. 206, p. 1. |
|
|