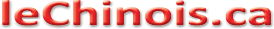Travaux de chercheurs en histoire
Textes
|
|
Rencontres interculturelles entre la Chine et le Canada/Québec au XXe siècle : la perception des jésuites dans la presse périodique québécoise de 1918 à 1949. par Victor Rochette-Coulombe page 11 familière. Une image rappelant les réminiscences d’une époque plus joyeuse dans un monde obscurci par la guerre. Un climat social difficile qui s’accentue avec cette publication du Devoir du 24 avril 1943 (Fig., 4.1) où on apprend la mort de certains Canadiens, comme celle du Père Prospère Bernard. Ce même Père jésuite que nous avons vu partir pour la Chine en 1938. Enfin, la période de l’après-guerre n’est guère plus joyeuse pour les Jésuites, mais offre quelques nouveautés. On remarque d’abord que le gouvernement canadien tente de faire la promotion de la culture chinoise. Cet intérêt pour la Chine d’après-guerre se matérialise par une série de conférences pancanadiennes sur la littérature chinoise. Ainsi, « MM. Shu Ch ‘ing Ch’un et Wan Chia Pao, écrivains de renom, sont en tournée au Canada ». Un épisode d’échange sino-québécois, encouragée par le Père Jean-Paul Dallaire, professeur au Collège philanthropique de jésuites de Chine, dans une lettre soumise au Devoir le 7 septembre 1946 (Fig., 4.2). Par cette lettre, qui fait la promotion des écrivains chinois, Shu Ch ‘ing Ch’un et Wan Chia Pao, on peut supposer qu’il y existait réellement un engouement de la population pour la Chine et sa culture confucianiste. L’idée semble donc, désormais, de promouvoir un nouvel allié, de faire la promotion de ces chinois qui avaient résisté à l’invasion japonaise et à ceux qui résistent toujours, en 1946, au « raz-de-marée communiste (15) ». D’ailleurs, si plusieurs jésuites reviennent au Canada, tels Alphonse Dubé, Louis Beaulieu et Émile Muller (15), d’autres continuent d’œuvrer à Süchow pendant la guerre civile de 1945 à 1949. Dans une autre publication de La Patrie du 16 mai 1949 (Fig., 4.5), on apprend que « 48 prêtres et frères enseignants, tous de la Compagnie de Jésus, font de l’apostolat missionnaire dans le territoire de la Chine occupé par les communistes et dans la ville assiégée de Shanghaï (17) ». Un dernier épisode de l’aventure apostolique canadienne-française qui prouve par leurs efforts de conversion presque ininterrompu pendant les deux guerres civiles, qui se terminent avec l’éviction des derniers Jésuites en 1955. |
14 Le Devoir, 7 septembre 1946, Vol. XXXVII, No. 206, p. 1 15 Le quotidien du Saguenay, cahier 5, 11 avril 1979, p. 8. 16 Le Progrès du Saguenay, 9 novembre 1931, p. 3. 17 Jocelyn Létourneau, op. cit., p. 202. |
|
|