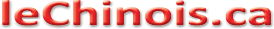Travaux de chercheurs en histoire
Textes
|
|
Les missionnaires jésuites québécois et leurs représentations des pratiques alimentaires chinoises durant le premier tiers du XXe siècle par Antoine Bouchard-Marchand page 5 D’autre part, il est également intéressant de se pencher sur l’aspect symbolique derrière les aliments que les Chinois décident de consommer tout en établissant une analyse dichotomique de la cuisine chinoise à travers l’opposition yang/yin[29]. En effet, la cuisine chinoise est profondément codée et les écrits missionnaires sont éclairants à ce sujet. Il est d’usage d’évoquer, et il ne faut pas l’oublier, que l’alimentation de Chinois peut facilement être liée à la médecine. Afin d’illustrer nos propos, nous retenons le passage où le Père Auguste Gagnon raconte que pour soigner sa fièvre asiatique, un médecin chinois lui fait manger de la quinine : « Arrivé à Chang-hai, visite au médecin qui me voyant gay et gras se demandait ce que je pouvais bien lui vouloir. Il me tourne, me retourne, me tapote : fièvre asiatique à la rate qui couve sous cendres. Jusqu’à date, j’ignorais avoir la rate dans la cendre et couvée de quelque chose. Il m’a fait bouffer de la quinine, donné des piqûres pour que ça ne revienne plus »[30]. La fièvre asiatique concernée ici n’a rien à voir avec la grippe asiatique de la fin des années 1950. Pour Auguste Gagnon, il s’agit probablement plutôt d’une manière de parler du paludisme. Vis-à-vis cet extrait, certaines questions nous viennent à l’esprit. La première concerne la quinine. Nous savons d’une part que la quinine goûte très amer et que pour soigner la rate, plusieurs traités de médecines chinoises encouragent l’usage du sucré[31]. De plus, on dit que pour soigner la fièvre, qui est causée par un excès de chaleur dans le corps, nous devons traiter ceci avec un aliment froid. Cependant, puisque la quinine a un goût amer, celle-ci est considérée comme étant de nature chaude[32]. Devant la nouvelle du Père Auguste Gagnon, certains traités de médecine chinoise et l’opposition yin/yang, nous nous questionnons pourquoi semble-t-il y avoir un manque de cohérence. Par ailleurs, il faut affirmer que l’usage de la quinine dans le but de soigner est reconnu depuis au moins l’extrême fin du XVIIe siècle. Dans l’un autre de ses livres, le sinologue Shenwen Li affirme que : […] en 1693, Kangxi, fort malade, est miné par une fièvre contre laquelle toute la pharmacopée traditionnelle demeure impuissante. Un bonze essaye de le guérir par des exercices mystérieux, mais sans succès. À ce moment crucial, les pères Gerbillon et Bouvet lui font prendre de l’écorce de quinquina que les pères de Fontaney et de Visdelou ont apportée à la cour. Ce médicament, récemment découvert, produit un effet immédiat et rétablit complètement l’empereur. [33] Conséquemment, les écrits du Père Auguste Gagnon nous confirment que la quinine est tout de même encore reconnue au début du XXe siècle comme étant un remède pour ses bienfaits soignants contre certains problèmes de santé. L’historien et ethnobiologiste George Métailié souligne quelques aspects intéressants au sujet de la santé du corps en fonction de ce que nous mangeons. Au regard de la diète chinoise : C’est par l’action réciproque de deux forces antagonistes appelées yin et yang que sont créés et mus toutes les choses et tous les êtres […] Pour que règne l’harmonie dans l’univers ou dans le corps, il faut qu’il y ait équilibre entre ces deux forces. Ainsi on explique qu’en cas d’excès de « chaud » dans le corps, fièvre par exemple, il est nécessaire de prendre du « frais » par la nourriture afin de rétablir l’harmonie entre yang et yin et donc recouvrer la santé. [34] En portant un regard attentif aux écrits missionnaires concernant la façon dont les Chinois perçoivent la nature qualitative des aliments, nous remarquons certaines différences culturelles en lien avec la valeur diététique chinoise versus la diététique canadienne[35]. En effet, nous pouvons établir que la perception chinoise vis-à-vis l’alimentation est davantage considérée à travers un prisme qualitatif. Ce faisant, et au contraire d’une réflexion de l’alimentation canadienne, les aliments sont définis en fonction de leurs propriétés thérapeutiques : tiède, chaud, humide, sec et froid. Il importe de préciser qu’il ne s’agit pas de température à proprement parler, mais bel et bien l’effet sur le corps[36]. Pour chaque nature, la pensée chinoise lui accorde des saveurs respectives et définit d’autant plus quelle partie du corps sera affectée[37]. Par ailleurs, la conception canadienne est plutôt quantitative. En effet, l’aliment est plutôt reconnu et considéré en fonction de sa quantité de calories, lipides, glucides, protéines, vitamines, etc. Cependant, la Chine est depuis 1912 une république et ceci a favorisé une ouverture sur le monde extérieur. Conséquemment, la nature de la médecine chinoise commence à être influencée par des savoirs occidentaux, mais ceci n’empêche pas de penser que cette diététique chinoise est connue et probablement encore très bien ancrée dans les mentalités[38]. |
[29] Xiao, op. cit., p.20-21 [30] Auguste Gagnon, « Quam Pulchri », Le Brigand, numéro 5, novembre 1930, p.7 [31] Métailié, loc. cit p.123 [32] Xiao, op. cit., p. 21 [33] Shenwen Li, Stratégies missionnaires des jésuites français en Nouvelle-France et en Chine au XVIIe siècle, Les Presses de l’Université Laval, Coll. Intercultures, Québec, 2001, p. 235 [34] Métailié, loc. cit., p. 122 [35] Xiao, op. cit., p. 36 [36] Éric Marie, Se nourrir des souffles et des saveurs : la diététique de la médecine chinoise, Transtextes Transcultures ??????, Vol. 10, 2015 a32039/Downloads/transtexts-602.pdf consulté le 19/03/22 [37] Métailié, loc. cit., p. 123 [38] Xiao, op. cit., p. 27 |
|
|