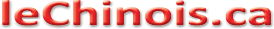Travaux de chercheurs en histoire
Textes
|
|
Les missionnaires jésuites québécois et leurs représentations des pratiques alimentaires chinoises durant le premier tiers du XXe siècle par Antoine Bouchard-Marchand page 6 Dans un autre ordre d’idée, notre autre source manuscrite et imprimée est celle écrite par le Père Édouard Lafortune : son journal de bord personnel. Nous retenons son chapitre intitulé : « Politesses compliquées et complications polies ». Lafortune parle d’un repas pour lequel un paysan chinois l’invite chez lui. Il nous informe comment son hôte le reçoit, quels plats lui sont offerts et quelles sont les marques de politesse à la table. En effet, le missionnaire Lafortune souligne la grande quantité de plats présents sur la table tout en rappelant l’importance de manger un peu de tout, sans quoi, le paysan chinois interpréterait les manières de table de Lafortune comme étant impolies : On me prépare donc soupe, petits pains, légumes, un peu de viande même (mets rare à la campagne), et deux ou trois desserts. Le tout, étalé à la fois devant moi, a la meilleure apparence. Peu sûr pourtant de mon estomac encore mal acclimaté, je voudrais choisir, entre les divers plats, ce qui me va le mieux. Mon hôte ne l’entend pas ainsi. Il a appris depuis toujours que la politesse exige de donner à un visiteur la plus grande variété possible de mets, entre lesquels celui-ci’n’est pas libre de faire son choix. Il faut prendre de tout, au moins un peu. Tant pis pour moi, si tel légume huileux ne me va pas. Quant au maître de céans, il est sûr d’une chose : c’est qu’il n’y a pas faute de son côté, et qu’il y en aurait une de ma part, à ne pas prendre de tout. [39] Le Père Lafortune est effectivement bavard vis-à-vis l’alimentation paysanne de Süchow. Tout comme le Père Renaud, Lafortune souligne également à son tour que la consommation de viande est rare en campagne. En plus de la viande, il fait mention des autres plats qu’on lui présente : une soupe, des petits pains, des desserts et des légumes. En portant un regard sur l’état des légumes, il en profite pour souligner et avouer qu’il éprouve certaines difficultés à s’adapter à la nourriture chinoise. En effet, devant l’apparence et la constitution des plats, le Père Lafortune et d’autres missionnaires sont confrontés à un patrimoine alimentaire différent de celui du Québec. Par ailleurs, il mentionne tout de même que les missionnaires ont plus d’un tour dans leur sac et qu’ils arrivent tant bien que mal à ne pas être obligés de manger des plats cuisinés exactement comme les Chinois ont l’habitude de faire en affirmant que : Se nourrit à la chinoise […] il faudrait distinguer. Manger à l’année des mets préparés à la chinoise, i.e. avec les huiles, les sauces, le piment, sans trop tenir compte des règles de notre hygiène, et cuits dans le chaudron n’est pas à conseiller. Il y aura toujours danger. […] manger des mets chinois préparés à notre manière sans les huiles, sauces ou piment est à conseiller. Mais il faudra compléter ces repas… autant que possible sans que cela paraisse… par quelque chose de plus substantiel et de mieux approprié à nos estomacs d’étranger. [40] Les extraits précédents démontrent l’adaptation parfois difficile des missionnaires vis-à-vis la cuisine chinoise. Il va sans dire que les jésuites ne sont pas les seuls à éprouver certaines difficultés à s’adapter. En effet, il en va de même pour les Chinois, qui eux, n’aiment pas non plus forcément toutes les facettes de la cuisine québécoise. De telles informations nous sont parvenues grâce aux écrits d’Antonio Dragon : « Nos invités mangent peu. Gâteaux et friandises sont trop sucrés à leur goût. Le Chinois préfère le salé »[41]. |
[39] Lafortune, op. Cit., p. 198 [40] Langlais, op. cit., p. 103 [41] Antonio Dragon, Le père Bernard, Montréal : Messager canadien, 1948, p. 214 et 215 |
|
|