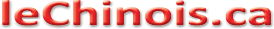Travaux de chercheurs en histoire
Textes
|
|
Les missionnaires jésuites québécois et leurs représentations des pratiques alimentaires chinoises durant le premier tiers du XXe siècle par Antoine Bouchard-Marchand page 7 1.2 Les représentations alimentaires chinoises à partir des objets Quittons les sources manuscrites et penchons-nous maintenant sur certaines sources matérielles. Le premier objet de notre corpus est une petite sculpture en bois (Annexe 1). On aperçoit ce qui semble être un homme adulte et un enfant devant une table remplie de melon d’eau tranché (7,5 × 5,5 × 5,7 cm). L’enfant tient une portion dans sa main et s’apprête à la manger. Les tranches de melon d’eau sont peintes de rouge et de points noirs pour représenter les pépins. Les personnages sont souriants. Nous considérons cette sculpture particulièrement intéressante et révélatrice des comportements alimentaires des Chinois. En nous prêtant à une lecture narrative de cette scène, nous apercevons un père et son fils, mais au-delà de cette lecture narrative, nous pouvons certainement nous prêter à une lecture un peu plus métaphorique de cette scène. Il va sans dire que le choix de ce fruit à l’intérieur d’une telle scène de partage entre membres d’une même famille ne semble pas être anodin. En effet, pour les Chinois, la charge symbolique du melon signifie l’unité familiale et l’idée de la fertilité[42]. Par ailleurs, il est intéressant d’insérer l’importance de la famille non seulement dans le cadre d’un repas festif, mais également à travers l’alimentation au quotidien. Nous portons maintenant notre attention sur la théière sur laquelle est représenté un détail sculpté en branche de prunier (Annexe 2). La théière (19,5 × 16 × 23 cm), s’agit d’une poterie de couleur brune avec plusieurs fleurs peintes d’une teinte plus pâle. En raison des conditions climatiques dans lesquelles le prunier pousse, ce fruit symbolise la fertilité et la persévérance puisque ce fruit (??) pousse en hiver[43]. La fleur de prunier est investie d’un profond et puissant sens philosophique et politique pour la civilisation chinoise depuis longtemps. Depuis le XIe siècle qu’on rencontre un développement iconographique de la fleur de prunier et à partir de l’invasion mongole, on considère la fleur de prunier comme un symbole de la résistance vis-à-vis l’oppresseur[44]. En portant un regard sur l’objet lui-même, vous n’êtes pas sans savoir que la consommation de thé occupe une place importante chez les Chinois. En effet, l’écrivain Lin Yu Tang (1895-1976) est un écrivain contemporain de notre période d’étude et il affirme que « Les Chinois aiment boire du thé : du thé à la maison, du thé au pavillon du thé , du thé en réunion, du thé pendant les controverses , du thé avant le repas, du thé après le repas. Avec une théière remplie de thé, ils sont aux anges »[45]. Il existe aussi plusieurs codes liés à la sociabilité et au partage du thé. En effet, « Boire du thé en solitaire est pour les Chinois la recherche d’un certain état d’esprit (??). Partager du thé à deux, on obtient le plaisir (??). Partager à trois, on sent les arômes (??). Partager à sept ou huit, il s’agit d’assouvir la soif »[46]. Notre dernier objet est une boîte à lunch (Annexes 3, 4 et 5). Elle est fabriquée en bois et solidifiée à l’aide de quelques plaques et vis métalliques stylisées (30,5 × 20 × 22 cm). Elle est composée de 2 compartiments, un couvercle muni d’une poignée et elle a une base octogonale. Ses couleurs varient selon certaines teintes de bois vernis. On remarque sur les plaques métalliques un détail sculpté ressemblant à un feuillage. On peut également repérer 4 symboles chinois sur son couvercle que l’on peut traduire par : grande ambition. Il est particulièrement intéressant de s’attarder sur ce qui est écrit sur son couvercle, car ceci permet possiblement de fournir des indices sur son propriétaire. Premièrement, un tel objet est généralement utilisé pour tous ceux qui s’absentent de la maison et qui amènent son repas. Cette boîte à lunch ressemble beaucoup à celles qu’on apporte lors des examens impériaux. En considérant le message de bon augure sur son couvercle, la boîte à lunch appartient possiblement à un étudiant. Ce message peut d’autant plus refléter le souhait et l’espoir de ses parents afin que leur fils réussisse[47]. Jusqu’en 1905[48], il existe en Chine un système d’examens impériaux qui se présente comme étant l’une des voies principales afin d’accéder à des postes de fonctionnaire d’État[49]. À vrai dire, il existe trois paliers à propos de ces examens : celui à l’échelle provinciale (Xiangshi), nationale (huishi) et impériale (dianshi)[50]. Selon le niveau de l’examen, le séjour peut durer jusqu’à plus d’une semaine[51]. De plus, il est possible que l’étudiant doive dormir sur place puisque ces examens se déroulent parfois loin de la maison. Une fois le moment venu de faire l’examen, l’étudiant s’installe dans une petite pièce dont il ne doit pas quitter jusqu’à ce qu’il soit terminé. Conséquemment, il doit donc prévoir d’amener avec lui de la nourriture[52]. Lors du séjour des missionnaires québécois à Süchow, bien que l’examen impérial soit déjà aboli, il existe bien entendu différents examens dans les écoles et des élèves auraient pu utiliser ce type de boîtes à lunch pour leur repas. Jusqu’à maintenant, nous n’avons rencontré aucune source primaire ou secondaire faisant mention des aliments et repas dans ces boîtes à lunch. |
[42] Marine Colliot, « La Signification des Fruits en Chine », Culture chinoise, 2018, https://ltl-chinois.fr/signification-fruits-en-chine/, consulté le 01/11/21 [43] Marie-Anne Destrebecq, « Le symbolisme de la fleur de prunier dans la philosophie, la politique et l’esthétique chinoises des Song à nos jours », Études chinoises, No. 21, Vol. 2, 2002, p. 197 https://www.persee.fr/doc/etchi consulté le 01/11/21 [44] Ibid., p. 198 [45] Li, Hao. « Eau et plaisir du thé », Peurs et Plaisirs de l’eau, Hermann, 2011, p. 305 https://doi-org.acces.bibl.ulaval.ca/10.3917/herm.barra.2011.01.0305 consulté le 19/03/22 [46] Ibid., p. 313 [47] Hou Rongrong, « Un panier d’examen est rempli de bonheurs et de malheurs », repéré sur le site Internet de Sohu, 2019, https://www.sohu.com/a/319214093_115479, consulté le 02/14/2022 [48] Meimei Wang, Bas Van Leeuwen et Jieli Li, Education in China, Ca. 1840-Present, Brill, 2020, p.6 [49] John King Fairbank et Merle Goldman, Histoire de la Chine : Des origines à nos jours, Taillandier, Texto, 2019 (1992), p. 147 [50] Shenwen Li, Stratégies missionnaires des jésuites français en Nouvelle-France et en Chine au XVIIe siècle, thèse de doctorat, Université Laval, Québec, 1998, p. 136 [51] Mark Cartwright, « The Civil Service Examinations of Imperial China », World History Encyclopedia, 2019 https://www.worldhistory.org/article/1335/the-civil-service-examinations-of-imperial-china/consulté le 01/11/21 [52] Rui Wang, The Chinese Imperal Examination Système : An Annontated Biography, Scarecrow Press, Maryland United-States, 2012, p. 77 |
|
|