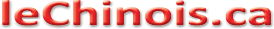Travaux de chercheurs en histoire
Textes
|
|
Rencontres interculturelles entre la Chine et le Canada/Québec au XXe siècle : la perception des jésuites dans la presse périodique québécoise de 1918 à 1949. par Victor Rochette-Coulombe page 5 Un facteur qui explique la prépondérance de cette région dans notre analyse et sa récurrence dans les sources textuelles. Financer, instruire, recommencer… Il faut aussi avouer que le succès de la mission est dû à l’efficacité de son financement. Le transport, l’hébergement et le quotidien des missionnaires n’étant pas gratuits, l’entreprise missionnaire canadienne avait besoin de beaucoup d’argent pour assurer le succès de son entreprise. Sur ce point, c’est le Père Joseph-Louis Lavoie (1886-1968) qui fut l’un des principaux artisans de ce financement. Après un séjour à Süchow de 1924 à 1928, il devint officieusement administrateur de la Procure de Chine à Québec en 1931 (11). Organisateur remarquable et visionnaire, le Père Lavoie mit sur pied une revue périodique qui va assurer une partie du financement des missions grâce aux relations régulières effectuées entre les missionnaires en Chine et leurs collègues restés au Canada. Intitulé « Le Brigand » en raison des nombreux épisodes de brigandages qui parasitent la région de Süchow pendant la guerre civile, la revue reste assez modeste au départ. En effet, le premier tirage publié en 1930 (11) ne compte que huit pages polycopiées qui sont appelées à se multiplier et se complexifier au fils des années (11). Néanmoins, elle contient quantité de témoignages sur la mission jésuite de la Province du Bas-Canada et qui relate le quotidien des missionnaires. En plus du Brigand, le Père Lavoie fonde un musée au 653 chemin Sainte-Foy, à Québec. Un musée jésuite dans lequel on exposait des objets, des « chinoiseries », rapportés des missions [Figure 3.5] et dont les entrées servaient à financer la mission de Süchow (11). En fait, ce sont ces activités de financement qui assurent une certaine visibilité aux missions. Nous le verrons dans la presse, les jésuites organisent des conférences et des expositions itinérantes un peu partout au Québec [Fig. 3.5] avec ces objets ramenés de Chine et qui sont toujours conservés au musée de la Civilisation à Québec (11). Parallèlement, il convient de rappeler que malgré la motivation de certains jésuites à promouvoir la culture chinoise par l’entremise de ces activités, d’autres sont restés figés dans un conservatisme religieux et racial. Une tendance polarisante qui s’illustre fréquemment dans Le Brigand et qui fragilise le sentiment de bonne volonté ressenti par d’autres jésuites. Si, d’un côté, on fait l’éloge de la culture chinoise, de ses traditions et |
| 11 Ibid., op. cit., p. 7. |
|
|