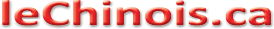Travaux de chercheurs en histoire
Textes
|
|
Rencontres interculturelles entre la Chine et le Canada/Québec au XXe siècle : la perception des jésuites dans la presse périodique québécoise de 1918 à 1949. par Victor Rochette-Coulombe page 6 de ses mœurs, de l’autre, la tendance est à l’intolérance et à la condescendance (11). Un aspect qui apparait parfois, de façon implicite, dans la presse de l’époque. Enfin, il faut aussi rappeler que les activités de financement des jésuites n’ont pas été faites en vain. Malgré la perte de la Procure canadienne avec l’avènement du régime communiste vers 1949, le musée parvient à ramener un nombre important de visiteurs et Le Brigand quadruple son tirage en cinq ans. Il est donc évident que les Jésuites ont attiré les sympathies d’un bon nombre de Québécois. Ad maiorem Dei gloriam! Les missions canadiennes en Chine furent plutôt dynamiques dans l’espace public québécois et surtout à partir de 1931. Le musée, la revue et les conférences semblent avoir fait connaître les réalisations des missionnaires canadiens pour la « gloire de Dieu », Ad Dei gloriam! Pourtant, il semble que la transition qui s’opère dans la société québécoise à la fin des années 1950, connue comme la « révolution tranquille », marque le déclin des pratiques religieuses dans les ménages québécois. Un important changement sociétal qui fait en sorte d’effacer progressivement l’épisode des missions jésuites en Chine de l’histoire du Québec. En fait, il est probable que la remise en cause du schéma « traditionnel » québécois dans les années 1960 (11) -- avec l’Église comme acteur prépondérant -- ait évacué le souvenir de l’intervention des missionnaires québécois en Chine de notre mémoire collective. Pour reconstruire ce « vide » historiographique avec rigueur, il faut se pencher sur les sources primaires : sur la presse périodique québécoise. D’abord, il faut comprendre que les premières années de la mission sont assez minimalistes au niveau de l’organisation. Les articles de journaux qui mentionnent les missionnaires jésuites sont donc plus courts entre 1918 et 1922 que de 1923 à 1930 (11). Et du coup, Il n’est pas rare de trouver de courtes publications comme celle de la fig. 2.1. à cette période. Par exemple, dans cette édition du journal La Presse daté du 21 août 1918 (11), on apprend simplement le départ du Père Paul Gagnon pour la Chine. Les phrases sont très courtes et la publication est insérée à la page sept soit, bien loin de la « première page » qui comporte, de manière générale, les éléments les plus probants d’un périodique. |
11 Le Devoir, 3 mars 1919, Vol. X, No. 51, p. 1. |
|
|