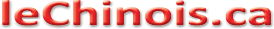Travaux de chercheurs en histoire
Textes
|
|
Rencontres interculturelles entre la Chine et le Canada/Québec au XXe siècle : la perception des jésuites dans la presse périodique québécoise de 1918 à 1949. par Victor Rochette-Coulombe page 7 Mais malgré la maigreur de premières publications, on peut tout de même déduire que les jésuites disposent d’une volonté de rendre leur activité publique. Un besoin de visibilité qui se remarque, car la photographie est souvent plus grande que la description. De ce fait, on peut comprendre qu’il y avait certainement un intérêt de la part du commanditaire de l’article de mettre en valeur l’individu au centre de celle-ci. Cette tendance se confirme dans plusieurs des cas étudiés. Suivant cet autre exemple tiré du Devoir et daté du 3 mars 1919 (Fig. 2.2), on peut lire que « si quelque jour, vous passez en Chine, vous pourrez tout à votre aise causer du Canada avec une couple de Jeunes Jésuites canadiens qui sont allés là-bas prêter main-forte à leurs frères français (11) ». Issu d’un texte plus important sur la mort du R.P. Lajoie figurant sur la première page, ce passage de l’article montre bien que les Jésuites ont déjà une place dans l’espace public québécois. En effet, les articles traitant des Jésuites sont récurrents dans la presse que nous avons dépouillée et plus spécialement, dans <1> Le Devoir et L’Action catholique . Du coup, la présence des Jésuites en Chine est certainement quelque chose de connu. Un constat qui se confirme avec ce tirage du 5 juin 1920 (11) (Fig. 2.3). Dans cette autre publication, on fait la mention d’une activité de financement au profit des Jésuites et de la mission en Chine. Si l’annonce est bien plus modeste que la précédente et se trouve à la douzième page du journal, l’existence d’une levée de fond au profit des Jésuites à Montréal, par l’entremise d’une certaine Mme Gagnon résidant au 387 rue Berri à Montréal, montre que les jésuites bénéficient bien d’une visibilité chez les Québécois. On peut effectivement penser que la récurrence des publications présume un auditoire régulier. Cette idée selon laquelle les jésuites bénéficiaient d’un auditoire régulier grâce à leurs publications, on peut la trouver dans un autre article du Devoir datée du 4 janvier 1921 (Fig. 2.4). Dans celui-ci, on peut lire la proposition de lecture du Père Paul Gagnon, ce même Jésuite que nous avions trouvé dans La Presse en 1918 et qui fut l’un des premiers missionnaires canadiens-français à avoir voyagé en Chine. Cette fois, le Père Gagnon propose aux lecteurs un ouvrage sur les missions françaises en Chine intitulé : |
11 Le Devoir, 3 mars 1919, Vol. X, No. 51, p. 1. |
|
|