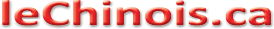Travaux de chercheurs en histoire
Textes
|
|
Rencontres interculturelles entre la Chine et le Canada/Québec au XXe siècle : la perception des jésuites dans la presse périodique québécoise de 1918 à 1949. par Victor Rochette-Coulombe page 8 La légende dorée en Chine: Scène de la vie de Mission au Tche-Li Sud-Est par Pierre Mertens (12). Ainsi, on peut présumer que les Jésuites avaient certainement un auditoire grandissant parmi les Québécois, sinon pourquoi se borner à publier des suggestions de lectures ou à continuer de mentionner le départ des Pères pour la Chine? Une tendance qui semble se poursuivre après 1923, car les articles se complexifient graduellement et leur présence semble devenir plus récurrente au cours des années 1920 et 1930. Ce phénomène de complexification et de récurrence s’illustre, notamment, avec une publication de La Presse daté du 24 septembre 1923. En effet, l’article montre les Pères Auguste Gagnon Georges Marin, Édouard Côté à leur retour de Zikawei en 1923 (12) (Fig., 2.5). Au premier coup d’œil, on remarque que les Jésuites sont au cœur de la page sur plusieurs angles. D’abord par la taille du titre, « Les missions des Jésuites en Chine », qui dépasse celle des publications précédentes. Ensuite par la taille de l’image, qui est aussi bien plus imposante que les autres. Et enfin, par la présence d’un texte qui fait mention de leur travail intitulé « Trois pères canadiens de Zi-Ka-Wei en font un beau tableau ». En outre, cette publication du 24 septembre 1923 se distingue des autres que nous avons étudié car elle se compose de plusieurs éléments visant à mettre en valeur les Jésuites. Auparavant, nous avons remarqué que la présence du texte est souvent inversement proportionnelle à la présence d’images. Du coup, on remarque qu’il y a eu une évolution marquée entre nos premières publications et celle-ci. Si la photographie est plus grande, la description de l’article est aussi plus éloquente sur l’activité missionnaire et met l’accent sur l’étude des langues et leur voyage en Chine. On peut lire que « les Jésuites sont chargés d’une grande mission divisée en trois vicariats apostoliques: Nankin, Ou-Hou et le Tchély méridional, où travaillent trois cents missionnaires. En plus du travail de conversion, ils ont organisé des institutions scientifiques supérieures, qui font honneur au nom catholique et préparent la pénétration des classes instruites de la société chinoise (...) (12)». Un constat intéressant qui nous permet de soulever deux tendances lourdes, soit la mise en forme d’une propagande religieuse visant à valoriser l’envoi de Canadiens-français outre-mer et l’omniprésence du facteur financier (12). |
12 Le Progrès du Saguenay, Vol. 45, No. 69, 9 novembre 1931, p. 6. |
|
|