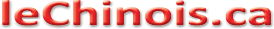Travaux de chercheurs en histoire
Textes
|
|
Rencontres interculturelles entre la Chine et le Canada/Québec au XXe siècle : la perception des jésuites dans la presse périodique québécoise de 1918 à 1949. par Victor Rochette-Coulombe page 9 Dans cet ordre d’idée, nous l’avons vu, le Père Lavoie, fondateur du Brigand et du Musée, s’impose comme l’un des principaux protagonistes de cette visibilité et du financement des missions. Effectivement, les conférences qu’il donnait un peu partout au Québec étaient, semble-t-il, très populaires et servaient à financer l’envoie de missionnaires outre-mer. D’ailleurs, ces conférences semblaient rencontrer un certain succès auprès des Saguenéens, comme le montre cet autre article publié dans un journal de Chicoutimi, Le Progrès du Saguenay (Fig., 3.1), intitulé La « Conférence instructive du R.P. Lavoie S.J. » Dans cet article, l’auteur mentionne que « la salle de représentation du théâtre (de Chicoutimi) était remplie ». Une remarque qui apparaît aussi dans un exemplaire du journal Le Soleil (14) à Québec et daté du 9 février 1933 (Fig., 3.2). Dans celui-ci, on peut lire cette fois que le « directeur du Musée chinois » donnait une « conférence sur les missions catholiques en Chine » et que le Père Lavoie a « attiré l’attention de ses auditeurs sur les immenses besoins des missionnaires catholiques, isolés et presque sans ressource (14) (…) ». D’une part, on peut déduire que le travail des Jésuites était surement bien reçu. Si l’on en croit les propos du journaliste, « la salle de représentation du théâtre était remplie ». D’autre part, la mention du Père Joseph-Louis Lavoie montre aussi que ce dernier est un acteur important du financement de la mission par la fréquence à laquelle il apparait dans les textes. Un constat qui montre que le personnage jouissait d’une place importante dans l’organisation et d’une certaine popularité. On le sait, il le principal acteur de la mise en place un réseau de communications non négligeable qui prend avec forme Le Brigand, le musée et ses publications sporadiques dans la presse panquébécoise. Parallèlement, cet article est aussi très intéressant pour comprendre comment certains Québécois pouvaient percevoir les Chinois au début du XXe siècle. Toujours dans notre publication du Soleil -- citée plus avant -- on peut lire « qu’il ne faut pas juger les Chinois de Chine sur les émigrés qui vont s’établir à l’étranger, aux États-Unis et au Canada, et embrassent des professions où ils espèrent se faire une fortune rapide. |
12 Le Progrès du Saguenay, Vol. 45, No. 69, 9 novembre 1931, p. 6. 13 Ibid. |
|
|